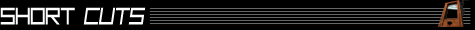
A LA UNE | A - I | I - P | Q - Z
Café transit
Kambozia Partovi
  L'Iran, à 50 kilomètres de la frontière turque. Un homme, Ismaïl, meurt, laissant une femme et deux enfants. La loi du lévirat impose que sa veuve, Reyhan, épouse Nasser, le frère d'Ismaïl. Mais Reyhan refuse et décide de reprendre le petit restaurant routier que tenait son mari. Grâce à ses talents culinaires, le restaurant devient la cantine préférée des routiers de passage. Mais Nasser et les siens entendent mettre fin à l'entreprise et faire rentrer Reyhan dans le giron familial. L'Iran, à 50 kilomètres de la frontière turque. Un homme, Ismaïl, meurt, laissant une femme et deux enfants. La loi du lévirat impose que sa veuve, Reyhan, épouse Nasser, le frère d'Ismaïl. Mais Reyhan refuse et décide de reprendre le petit restaurant routier que tenait son mari. Grâce à ses talents culinaires, le restaurant devient la cantine préférée des routiers de passage. Mais Nasser et les siens entendent mettre fin à l'entreprise et faire rentrer Reyhan dans le giron familial.
Scénariste du Cercle de Jafar Panahi (Lion d'or à Venise en 2000), Kambozia Partovi explore à nouveau la condition de la femme iranienne et sa lutte contre l'asservissement. Clairement féministe, Café Transit est avant tout le portrait d'une femme qui cherche moins à se rebeller contre le système patriarcal, qu'à trouver la place qu'elle peut légitimement y tenir. La question du territoire est ici essentielle. Quand le restaurant est ouvert, Reyhan reste invisible de la clientèle masculine : elle reste confinée dans la cuisine, d'où seule une petite ouverture lui permet d'épier la salle. La cuisine est à la fois le lieu de sa claustration, mais c'est aussi son domaine, et aucun homme excepté son beau-frère ne peut en franchir le seuil. De même Nasser, pour la convaincre de rejoindre sa famille, ajoute une pièce à sa maison, qui lui sera réservée. Mais Reyhan refuse car elle n'existerait alors plus que comme seconde épouse. Le film montre d'ailleurs très bien que la domination masculine est aussi entretenue par les femmes : la mère de Nasser (extraordinaire silhouette, avec son tic à la langue et son regard de renoncement) et la première épouse, qui lui reproche de rendre Nasser odieux.
Au fond, ce qui est reproché à Reyhan, c'est de pouvoir se passer d'un homme, d'être capable de subvenir elle-même à ses besoins en cuisinant. Toutes les raisons qu'elle peut invoquer, même son désir de rester fidèle au mari qu'elle aimait, se butent à un seul argument : la tradition. Condamnée à se taire, Reyhan trouve dans ses talents culinaires un autre mode d'expression. Comme dans Be with me ou le Festin de Babette, la cuisine est ici un langage. Dans ce lieu frontalier où se côtoient diverses langues, les plats savoureux mitonnés par Reyhan forment l'espéranto autour duquel un nouveau foyer peut se reconstituer.
Zakariyo, le beau routier grec que sa femme a quitté, et Svieta, jeune Russe qui cherche à gagner l'Europe, y trouvent la chaleur familiale qui leur manquait. Sans parler la même langue, les personnages se comprennent car leurs destins se ressemblent : ils ont connu la guerre, l'exil et l'abandon. Mais lorsque Zakaryio, tombé amoureux de Reyhan, utilise pour la convaincre de partir avec lui la même méthode que Nasser (il offre des cadeaux aux enfants), lui aussi devient une menace pour son indépendance. Pour rester libre, Reyhan est condamnée à la solitude. Tel est le constat amer de ce film limpide et poignant, porté par la présence lumineuse de Fereshteh Sadre Orfaei. — Damien Panerai
Viva Cuba
Juan Carlos Cremati Alberti
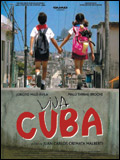  D'abord, Viva Cuba apparaît comme une sorte de Roméo et Juliette entre deux enfants cubains dont les familles se haïssent : Malu, issue de l'ancienne bourgeoisie havanaise catholique, et Jorgito, d'une famille plus modeste, athée et pro-castriste. Mais, parce qu'ils risquent de se retrouver séparés, les deux enfants font une fugue pour retrouver le père de Malu, à l'autre bout du pays. La chronique vire alors au road-movie touristique. Les moyens de locomotion se succèdent : train, bus, auto-stop, charrette, moto... Les enfants doivent ruser, voler de la nourriture, se déguiser... Pendant ce temps, les mères se réconcilient dans le malheur. D'abord, Viva Cuba apparaît comme une sorte de Roméo et Juliette entre deux enfants cubains dont les familles se haïssent : Malu, issue de l'ancienne bourgeoisie havanaise catholique, et Jorgito, d'une famille plus modeste, athée et pro-castriste. Mais, parce qu'ils risquent de se retrouver séparés, les deux enfants font une fugue pour retrouver le père de Malu, à l'autre bout du pays. La chronique vire alors au road-movie touristique. Les moyens de locomotion se succèdent : train, bus, auto-stop, charrette, moto... Les enfants doivent ruser, voler de la nourriture, se déguiser... Pendant ce temps, les mères se réconcilient dans le malheur.
Pétri de bonnes intentions (célébrer l'enfance et la liberté), Viva Cuba n'évite hélas pas la lourdeur, ni la carte postale. Quelques effets spéciaux tentent une envolée vers le merveilleux : une plante fleurit à vue d'oeil, les étoiles dansent en un feu d'artifice, un personnage de cartoon apparaît... Mais la poésie ne fonctionne guère, et les quelques gags laissent de marbre. Le problème tient surtout au point de vue adopté par Juan Carlos Cremati Alberti, censé être celui des deux enfants. Ceux-ci sont forcément plus malins que les adultes, qu'ils bernent aisément, mais l'on ne croit pas toujours aux situations, aux émotions surjouées des deux jeunes acteurs, ni aux dangers qui les guettent. Reposant sur une vision mythifiée, édulcorée de l'enfance, le film tombe facilement dans une certaine mièvrerie. C'est dommage, car quelques scènes et personnages réussis (la grand-mère, la femme aveugle) laissent entrevoir ce que Viva Cuba aurait pu être, débarrassé de cette naïveté un peu forcée. — Damien Panerai
Slevin (Lucky number Slevin)
Paul McGuigan
  Distribution alléchante pour un énième film de petit malin. Slevin appartient à cette famille de longs-métrages servis par un scénario quelque peu retors cherchant à balader le spectateur sur de fausses pistes, avant de lui dévoiler le fin mot de l'histoire. Distribution alléchante pour un énième film de petit malin. Slevin appartient à cette famille de longs-métrages servis par un scénario quelque peu retors cherchant à balader le spectateur sur de fausses pistes, avant de lui dévoiler le fin mot de l'histoire.
Avec force de retours en arrière, histoire de signifier au spectateur égaré qu'il n'y a aucune place au hasard, les scènes les plus anodines prennent d'un coup toute leur dimension. Sur un mode désinvolte, le film suit les mésaventures d'un jeune poissard qui, pris pour un autre, se retrouve malgré lui au milieu d'une guerre que se livrent deux caïds, le Boss et le Rabbin. Mais la scène d'ouverture, qui montre le massacre d'un parieur malchanceux et de sa famille, plusieurs années auparavant, constitue un relativement précieux indice sur les véritables enjeux de cette apparente méprise. On devine alors qu'il s'agit davantage d'un film de vengeance, stylisé à souhait, et il ne reste alors plus qu'à se laisser emporter par la mécanique bien huilée de l'ensemble, menée par un Josh Hartnett qui se fait plaisir à jouer les dilettantes décontractés (il faut le voir donner la réplique, nu sous sa serviette éponge, à un chef de gang) pour mieux dévoiler son vrai visage. On est loin des mises en scène machiavéliques à la Singer (Slevin n'est pas Keyzer Söze), mais puisqu'il est question de jeu tout au long de ce film, autant s'y prêter.
— Moland Fengkov
Hooligans
Nobuhiro Suwa
  Avec un titre aussi explicite, on sait à quoi s'en tenir. Dans Hooligans, premier film de Lexi Alexander, ancienne championne de karaté et de kickboxing, ça castagne dans les arrière-cours des pubs anglais. Mais le film ne vaut pas pour ces scènes de combats de rue, et encore moins pour le portrait qu'il dresse de supporters de clubs de football, plus ou moins des gens ordinaires dans la vie quotidienne, possédant un travail honnête, une famille, une maison, mais qui se transforment en chiens enragés dès que leur équipe favorite dispute un match. Loin d'être un documentaire, cette plongée dans un monde où les codes et l'honneur se déclinent au gré des amitiés viriles et des faits d'armes, fonctionne avant tout selon la recette éculée de l'élément extérieur (ici Elijah Wood, dans le rôle d'un jeune étudiant en journalisme viré d'Harvard pour un délit qu'il n'a pas commis) infiltré dans un monde qui le dépasse, et qui va suivre un parcours initiatique dont personne ne sortira indemne. Honnête, donc, servi par des comédiens qui connaissent la chanson (en l'occurrence l'hymne de leur club), une histoire qui se veut universelle, ce film qui refuse tout manichéisme au sujet de la violence des Hooligans, s'en sort sans trop de bleus. — Moland Fengkov Avec un titre aussi explicite, on sait à quoi s'en tenir. Dans Hooligans, premier film de Lexi Alexander, ancienne championne de karaté et de kickboxing, ça castagne dans les arrière-cours des pubs anglais. Mais le film ne vaut pas pour ces scènes de combats de rue, et encore moins pour le portrait qu'il dresse de supporters de clubs de football, plus ou moins des gens ordinaires dans la vie quotidienne, possédant un travail honnête, une famille, une maison, mais qui se transforment en chiens enragés dès que leur équipe favorite dispute un match. Loin d'être un documentaire, cette plongée dans un monde où les codes et l'honneur se déclinent au gré des amitiés viriles et des faits d'armes, fonctionne avant tout selon la recette éculée de l'élément extérieur (ici Elijah Wood, dans le rôle d'un jeune étudiant en journalisme viré d'Harvard pour un délit qu'il n'a pas commis) infiltré dans un monde qui le dépasse, et qui va suivre un parcours initiatique dont personne ne sortira indemne. Honnête, donc, servi par des comédiens qui connaissent la chanson (en l'occurrence l'hymne de leur club), une histoire qui se veut universelle, ce film qui refuse tout manichéisme au sujet de la violence des Hooligans, s'en sort sans trop de bleus. — Moland Fengkov
Un Couple parfait
Nobuhiro Suwa
  "Un couple parfait" aux yeux des autres, qui ne se regarde jamais dans les yeux : s'ils en partagent l'affiche, unique moment de tendresse parce que sans histoire, Valeria Bruni-Tedeschi et Bruno Todeschini se fuient à l'image tout au long du nouveau film de Nobuhiro Suwa. De leur histoire, on ne saura pourtant rien de plus que quelques éléments structurels, vidés d'émotion : Marie et Nicolas forment un couple depuis une quinzaine d'années. Ils vivent à Lisbonne, lui est architecte, elle a abandonné la photographie après les Beaux-Arts. Ils ont des amis sur Paris, et c'est le prétexte du mariage de l'un d'eux qui les réunit le temps (filmé) de ces quelques jours de pré-séparation dans une chambre d'hôtel, avec portes communicantes. Dans un décor austère aux couleurs passées et pénombre maîtresse, des touches de lumière en abat-jour conique, récurrentes et franches, se répondent d'un espace à l'autre de la chambre, en miroirs (omniprésents) les unes des autres; une image de peintre, sans cesse rappelée par les nombreux cadres qui habillent chacun des plans, mais dans lesquels on ne pénètre jamais : la peinture se dessine entre les protagonistes de la rupture, décalant leur forme, obligeant l'une au floue quand l'autre est nette ou cherchant l'alibi du reflet pour confronter enfin les personnalités. Nicolas et Marie ne se regardent pas, ils ne se regardent plus. L'histoire d'amour est finie, reste l'histoire du désamour, qui elle ne fait que commencer : on en suit chaque étape à l'écran, une minutie rythmée par des non-dialogues murmurés ou étranglés qui disent le malaise de n'être plus ensemble alors même qu'on l'est encore. Film claustrophobe, à la recherche d'une respiration qui lui est refusée jusque dans ses possibles (Todeschini donne rendez-vous à une invitée du mariage dans un café; Bruni-Tedeschi retrouve un ancien camarade des Beaux-Arts au Musée Rodin - étonnant Alex Descas, ici à contre-emploi), Un couple parfait tourne et retourne inexorablement le couteau de son titre cynique dans une plaie à vif, qu'une fin ouverte interdit définitivement de cicatriser. — Laurent Herrou "Un couple parfait" aux yeux des autres, qui ne se regarde jamais dans les yeux : s'ils en partagent l'affiche, unique moment de tendresse parce que sans histoire, Valeria Bruni-Tedeschi et Bruno Todeschini se fuient à l'image tout au long du nouveau film de Nobuhiro Suwa. De leur histoire, on ne saura pourtant rien de plus que quelques éléments structurels, vidés d'émotion : Marie et Nicolas forment un couple depuis une quinzaine d'années. Ils vivent à Lisbonne, lui est architecte, elle a abandonné la photographie après les Beaux-Arts. Ils ont des amis sur Paris, et c'est le prétexte du mariage de l'un d'eux qui les réunit le temps (filmé) de ces quelques jours de pré-séparation dans une chambre d'hôtel, avec portes communicantes. Dans un décor austère aux couleurs passées et pénombre maîtresse, des touches de lumière en abat-jour conique, récurrentes et franches, se répondent d'un espace à l'autre de la chambre, en miroirs (omniprésents) les unes des autres; une image de peintre, sans cesse rappelée par les nombreux cadres qui habillent chacun des plans, mais dans lesquels on ne pénètre jamais : la peinture se dessine entre les protagonistes de la rupture, décalant leur forme, obligeant l'une au floue quand l'autre est nette ou cherchant l'alibi du reflet pour confronter enfin les personnalités. Nicolas et Marie ne se regardent pas, ils ne se regardent plus. L'histoire d'amour est finie, reste l'histoire du désamour, qui elle ne fait que commencer : on en suit chaque étape à l'écran, une minutie rythmée par des non-dialogues murmurés ou étranglés qui disent le malaise de n'être plus ensemble alors même qu'on l'est encore. Film claustrophobe, à la recherche d'une respiration qui lui est refusée jusque dans ses possibles (Todeschini donne rendez-vous à une invitée du mariage dans un café; Bruni-Tedeschi retrouve un ancien camarade des Beaux-Arts au Musée Rodin - étonnant Alex Descas, ici à contre-emploi), Un couple parfait tourne et retourne inexorablement le couteau de son titre cynique dans une plaie à vif, qu'une fin ouverte interdit définitivement de cicatriser. — Laurent Herrou
Wolf creek
Christian Volckman
  Wolf Creek fait partie de ces œuvres mineures dont l'indigence de la mise en scène promet dès les premiers plans un ennui profond. Pourtant, à y regarder de près, on peut deviner que cet énième film de slasher australien se situant entre Razorback et Hitcher, se démarque de ses confrères américains, avant tout par le nombre peu élevé de victimes. Comment susciter l'intérêt du spectateur avec seulement trois victimes potentielles perdues dans de grands espaces (pas assez exploités à leur juste mesure) vides de seconds rôles trucidables, quand ce genre d'entreprise doit s'acquitter d'une liste conséquente de mise à mort pour satisfaire un public exigeant rompu aux effusions de sang en cascade ? Greg McLean trouve la réponse en faisant de ce road-movie horrifique un huis clos à ciel ouvert. Le malaise qu'on peut ressentir, une fois entré dans le vif du sujet, - la rencontre des trois étudiants avec leur bourreau -, vient non pas des scènes de tortures, qui ne montrent pas grand chose, ni des exécutions sommaires (on n'assiste pas à la mort de Liz, même si son sort ne soulève aucun doute, Ben survit, tandis que la dernière passe de vie à trépas dans un plan large, recevant le coup de grâce hors champ) mais de l'étirement du temps. Rien, même pas la route rectiligne (le retour à la civilisation) se perdant dans l'infini de l'horizon, ne s'ouvre sur un salut possible, faisant du bush australien une vaste prison où rôde le bourreau. Finalement, les défauts de rythme provoquent involontairement un effet qui sert le film, en suscitant l'agacement puis le malaise. La stupidité des protagonistes, qui les ramène inexorablement vers le lieu qu'ils fuient, et la répétition de plans superflus où on ne voit rien d'autre que l'espace qui s'étire et les fuyards ne sachant plus trop quelle direction prendre pour survivre, permettent à la dernière partie du métrage d'atteindre son but : pousser le spectateur dans ses derniers retranchements en l'enfermant dans un paradoxal sentiment de claustrophobie. — Moland Fengkov Wolf Creek fait partie de ces œuvres mineures dont l'indigence de la mise en scène promet dès les premiers plans un ennui profond. Pourtant, à y regarder de près, on peut deviner que cet énième film de slasher australien se situant entre Razorback et Hitcher, se démarque de ses confrères américains, avant tout par le nombre peu élevé de victimes. Comment susciter l'intérêt du spectateur avec seulement trois victimes potentielles perdues dans de grands espaces (pas assez exploités à leur juste mesure) vides de seconds rôles trucidables, quand ce genre d'entreprise doit s'acquitter d'une liste conséquente de mise à mort pour satisfaire un public exigeant rompu aux effusions de sang en cascade ? Greg McLean trouve la réponse en faisant de ce road-movie horrifique un huis clos à ciel ouvert. Le malaise qu'on peut ressentir, une fois entré dans le vif du sujet, - la rencontre des trois étudiants avec leur bourreau -, vient non pas des scènes de tortures, qui ne montrent pas grand chose, ni des exécutions sommaires (on n'assiste pas à la mort de Liz, même si son sort ne soulève aucun doute, Ben survit, tandis que la dernière passe de vie à trépas dans un plan large, recevant le coup de grâce hors champ) mais de l'étirement du temps. Rien, même pas la route rectiligne (le retour à la civilisation) se perdant dans l'infini de l'horizon, ne s'ouvre sur un salut possible, faisant du bush australien une vaste prison où rôde le bourreau. Finalement, les défauts de rythme provoquent involontairement un effet qui sert le film, en suscitant l'agacement puis le malaise. La stupidité des protagonistes, qui les ramène inexorablement vers le lieu qu'ils fuient, et la répétition de plans superflus où on ne voit rien d'autre que l'espace qui s'étire et les fuyards ne sachant plus trop quelle direction prendre pour survivre, permettent à la dernière partie du métrage d'atteindre son but : pousser le spectateur dans ses derniers retranchements en l'enfermant dans un paradoxal sentiment de claustrophobie. — Moland Fengkov
Renaissance
Christian Volckman
  Epoustouflante ambiance graphique que celle de Renaissance. Le principal atout de ce film d'animation entièrement réalisé en images numériques frappe dès les premières images. Un noir et blanc contrasté à l'extrême, proche de ce que peut nous offrir la bande dessinée, un univers à part entière, ce qui relève de la gageure pour la science-fiction : se départir de ses influences et se faire démiurge de son propre monde. Des mouvements de caméra inventifs exploitant les moindres recoins du décor (un Paris futuriste respectant son identité architecturale), à la verticale des murs et à la diagonale des lignes tracées par les rues et les sols de verre. Hélas, passé l'émerveillement de la réalisation graphique, on reste sur sa faim. Le film a tout misé sur la technique, au détriment du scénario, famélique et déjà-vu. Le meilleur de la bande dessinée côtoie ses plus tristes travers : sécheresse des dialogues, psychologie des personnages digne d'un Luc Besson au stade anal (le personnage du flic viril et bourru, traînant un traumatisme expliquant ses manières frustres, les méchants à la mine patibulaire, la bombe sexuelle au grand cœur, etc.). Mêmes les scènes de poursuites et de combats misent tout sur les mouvements de caméra, au détriment de l'action elle-même. Le film ne tient pas la durée, ne sachant résoudre son problème de rythme, ce qui entraîne un désintérêt quasi-total pour l'intrigue. Même les mouvements des personnages, dont on nous vente les mérites (la technique du motion-capture - élaborée à partir de l'enregistrement des gestes d'acteurs en chair et en os - constitue l'un des arguments de vente du film) finissent par nuire à l'ensemble par leur systématisme. Paradoxalement, les corps semblent peser le même poids, se mouvoir de la même façon, à la même vitesse. Au final, on ne retient que cette photographie léchée qui aurait fait le succès d'un bon jeu vidéo aux séquences cinématiques (scènes développées en dehors des phases de jeu) presque révolutionnaires. — Moland Fengkov Epoustouflante ambiance graphique que celle de Renaissance. Le principal atout de ce film d'animation entièrement réalisé en images numériques frappe dès les premières images. Un noir et blanc contrasté à l'extrême, proche de ce que peut nous offrir la bande dessinée, un univers à part entière, ce qui relève de la gageure pour la science-fiction : se départir de ses influences et se faire démiurge de son propre monde. Des mouvements de caméra inventifs exploitant les moindres recoins du décor (un Paris futuriste respectant son identité architecturale), à la verticale des murs et à la diagonale des lignes tracées par les rues et les sols de verre. Hélas, passé l'émerveillement de la réalisation graphique, on reste sur sa faim. Le film a tout misé sur la technique, au détriment du scénario, famélique et déjà-vu. Le meilleur de la bande dessinée côtoie ses plus tristes travers : sécheresse des dialogues, psychologie des personnages digne d'un Luc Besson au stade anal (le personnage du flic viril et bourru, traînant un traumatisme expliquant ses manières frustres, les méchants à la mine patibulaire, la bombe sexuelle au grand cœur, etc.). Mêmes les scènes de poursuites et de combats misent tout sur les mouvements de caméra, au détriment de l'action elle-même. Le film ne tient pas la durée, ne sachant résoudre son problème de rythme, ce qui entraîne un désintérêt quasi-total pour l'intrigue. Même les mouvements des personnages, dont on nous vente les mérites (la technique du motion-capture - élaborée à partir de l'enregistrement des gestes d'acteurs en chair et en os - constitue l'un des arguments de vente du film) finissent par nuire à l'ensemble par leur systématisme. Paradoxalement, les corps semblent peser le même poids, se mouvoir de la même façon, à la même vitesse. Au final, on ne retient que cette photographie léchée qui aurait fait le succès d'un bon jeu vidéo aux séquences cinématiques (scènes développées en dehors des phases de jeu) presque révolutionnaires. — Moland Fengkov
El Aura
Fabian Bielinski
  Les crises d'épilepsies d'un taxidermiste impassible rythment le nouveau film de Fabian Bielinsky, El Aura. L'aura précède la crise, c'est le moment, médicalement identifié, pendant lequel le malade sait que la crise va se produire, un état particulier d'hypersensibilité qui "ouvre une porte dans le cerveau", le rend perméable à la fois à tout ce qui l'entoure et à tout ce qui est enregistré (et refoulé) dans ses bases de données neuronales. Les crises d'épilepsies d'un taxidermiste impassible rythment le nouveau film de Fabian Bielinsky, El Aura. L'aura précède la crise, c'est le moment, médicalement identifié, pendant lequel le malade sait que la crise va se produire, un état particulier d'hypersensibilité qui "ouvre une porte dans le cerveau", le rend perméable à la fois à tout ce qui l'entoure et à tout ce qui est enregistré (et refoulé) dans ses bases de données neuronales.
Les portes ouvertes d'Esteban Espinosa (Ricardo Darin, incrédule d'un bout à l'autre) recomposent les divers éléments de son quotidien : une épouse absente, un ami violent, un musée d'histoire naturelle peuplé de renards et de cerfs empaillés, une propension pour les faits divers qu'il dissèque au même titre que ses bêtes mortes. Et de proposer au spectateur un scénario sombre dans lequel le héros exploite à chaud sa mémoire infaillible pour dénouer les ficelles de l'organisation d'un hold-up et finalement prendre part, malgré lui, au braquage sanglant d'un casino de campagne, renfloué par un week-end d'affluence.
Une navigation entre rêve et réalité, ponctuée par les pertes de connaissance opportunes du héros (l'accident de chasse, le hold-up), une virée en enfer hantée par le regard vairon d'un chien-loup magnétique, figure à la fois protectrice et menaçante, seule trouvaille habitée d'un casting sans surprise.
La lumière parfaite, verte et livide, du soleil froid à travers la forêt argentine ne parvient pourtant pas à convaincre le spectateur qui s'arrête à la lisière du bois, comme Esteban restera en retrait de son propre fantasme, trop transparent pour en être attachant, trop artificiel pour en être vivant, taxidermé ? — Laurent Herrou
Wu Ji, La Légende Des Cavaliers Du Vent
Chen Kaige
  Après le visionnage de la niaiserie soyeuse de Feu De Glace, difficile de subodorer que Chen Kaige, l'auteur de Terre Jaune et d'Adieu Ma Concubine, pouvait réaliser un film plus médiocre d'autant que L'Enfant Au Violon semblait redresser un peu la barre. Après le visionnage de la niaiserie soyeuse de Feu De Glace, difficile de subodorer que Chen Kaige, l'auteur de Terre Jaune et d'Adieu Ma Concubine, pouvait réaliser un film plus médiocre d'autant que L'Enfant Au Violon semblait redresser un peu la barre.
D'où la perplexité dans laquelle nous plonge la boursouflure lénifiante Wu Ji. Vague resucée du déchaînement visuel dont Zhang Ymou détient l'apanage depuis Hero. Sans en approcher toutefois la plus infime bribe poétique, le long-métrage pâtit d'un recours incompréhensible à une kyrielle d'effets spéciaux d'une hideur repoussante saupoudrée des miasmes d'une bluette à la bêtise abyssale.
L'harmonie luxuriante du Secret Des Poignards Volants ou la légèreté apaisée du féodal Tigre Et Dragon demeure diligemment éconduite dans cette bouillie frelatée de motifs picturaux grotesques (aplats de couleurs vives, abstraction de la cage géante et des robes de plumes…), de complots politiques éventés et de morale balourde. Que dire enfin d'un script hâbleur, flanqué de tous les poncifs et agrégeant quiproquos de vaudeville et retour en arrière temporel salvateur à la Superman ? Alors certes les acteurs sont d'une beauté indéniable mais filmés comme des pantins médusés et lyophilisés, ils ne peuvent que sceller le destin funeste de cette charogne à gros budget, désastreuse et indigne.
— Frédéric Flament
Du Jour Au Lendemain
Philippe Le Guay
  Sur un postulat limpide - après un lundi catastrophique, François Berthier vit un mardi idyllique sur tous les plans - Philippe Le Guay brode une comédie anxieuse et ouatée dans la lignée de ses précédents Trois Huit et Le Coût De La Vie. Surprise de retrouver un Benoît Poelvoorde filmé en mode mineur comme jadis Vincent Lindon et portant sans emphase une histoire au bord d'une confortable et insipide dispersion. Non dénué d'indéniables qualités (interprétation, envolées musicales façon Les Sentiments, représentation probante des locaux professionnels ou rythme inquiet), le long métrage pêche lorsqu'il s'évertue à concaténer un burlesque mal assumé avec la gravité sourde d'une fable humaniste. Difficile alors de tenir la comparaison avec le mémorable Un Jour Sans Fin qu'il érige en parangon et sa propension bohème à exploiter le plus infime détraquement de son script. La peur panique du bonheur ou l'ergastule d'un quotidien fané pour un quadra tour à tout opprimé, béat ou véhément aurait pu donner lieu à une diatribe corrosive ou une fantaisie tordante, dommage alors que Du Jour Au Lendemain se complaise dans le carcan étriqué, convenu et bien trop systématique de la logique du traumatisme. Nous décelons ça et là de véritables interrogations sur une existence cyanosée mais on aurait préféré que le film s'emploie avec plus de constance à se projeter hors de lui-même. — Frédéric Flament Sur un postulat limpide - après un lundi catastrophique, François Berthier vit un mardi idyllique sur tous les plans - Philippe Le Guay brode une comédie anxieuse et ouatée dans la lignée de ses précédents Trois Huit et Le Coût De La Vie. Surprise de retrouver un Benoît Poelvoorde filmé en mode mineur comme jadis Vincent Lindon et portant sans emphase une histoire au bord d'une confortable et insipide dispersion. Non dénué d'indéniables qualités (interprétation, envolées musicales façon Les Sentiments, représentation probante des locaux professionnels ou rythme inquiet), le long métrage pêche lorsqu'il s'évertue à concaténer un burlesque mal assumé avec la gravité sourde d'une fable humaniste. Difficile alors de tenir la comparaison avec le mémorable Un Jour Sans Fin qu'il érige en parangon et sa propension bohème à exploiter le plus infime détraquement de son script. La peur panique du bonheur ou l'ergastule d'un quotidien fané pour un quadra tour à tout opprimé, béat ou véhément aurait pu donner lieu à une diatribe corrosive ou une fantaisie tordante, dommage alors que Du Jour Au Lendemain se complaise dans le carcan étriqué, convenu et bien trop systématique de la logique du traumatisme. Nous décelons ça et là de véritables interrogations sur une existence cyanosée mais on aurait préféré que le film s'emploie avec plus de constance à se projeter hors de lui-même. — Frédéric Flament
Firewall
Richard Loncraine
  Lorsqu'un ami aux goûts cinématographiques douteux vous traîne au cinéma un samedi soir d'extrême désoeuvrement, vous vous retrouvez par politesse mais contre votre bon gré dans une salle, à suivre les " exploits " d'un héros quasi-grabataire exterminant à mains nus une dizaine de gangsters surarmés. Certains acteurs savent viellir — quelqu'un comme Clint Eastwood assume sa vieillesse quoique s'il décidait d'enfiler une fois de plus son poncho ou de sortir de son tiroir son 44 magnum, il aurait assez de crédibilité pour encore faire des dégâts — tandis que d'autres comme Harrisson Ford semblent croire qu'ils sont encore dans la force de l'age, ce qui, à l'écran tourne à la farce, vous faisant attendre avec " impatience " Indiana Jones 4 : les aventuriers de la maison de retraite. — Fred Thom Lorsqu'un ami aux goûts cinématographiques douteux vous traîne au cinéma un samedi soir d'extrême désoeuvrement, vous vous retrouvez par politesse mais contre votre bon gré dans une salle, à suivre les " exploits " d'un héros quasi-grabataire exterminant à mains nus une dizaine de gangsters surarmés. Certains acteurs savent viellir — quelqu'un comme Clint Eastwood assume sa vieillesse quoique s'il décidait d'enfiler une fois de plus son poncho ou de sortir de son tiroir son 44 magnum, il aurait assez de crédibilité pour encore faire des dégâts — tandis que d'autres comme Harrisson Ford semblent croire qu'ils sont encore dans la force de l'age, ce qui, à l'écran tourne à la farce, vous faisant attendre avec " impatience " Indiana Jones 4 : les aventuriers de la maison de retraite. — Fred Thom
Underworld 2 : Evolution
Len Wiseman
  L'idée aurait pu séduire : une guerre entre vampires et loups-garous traversant les siècles, avec en première ligne une belle tueuse partageant la même garde-robe sexy que celle de la Trinity de Matrix. Sur le plan du sex-appeal, Kate Beckinsale n'a rien à envier à Carrie-Ann Moss. Seulement voilà, Underworld échouait à créer un univers propre et original, et ne parvenait pas à sauver son entreprise en passant à côté de ce qui aurait pu constituer son point fort : les scènes d'action. Trop peu nombreuses, trop confuses et trop peu spectaculaires, quand ce genre de film exige une surenchère visuelle face à ses prédécesseurs. Avec le second opus, Underworld 2, les principaux défauts ont été gommés. Plus d'action donc, avec quelques ralentis bien venus et des métamorphoses de lycanthropes plus réussies. Exit les décors urbains, place à la forêt transylvanienne. Hélas, le grand méchant vampire aux traits de gargouille dotée d'ailes de chauve-souris ne procure aucun frisson, et le bellâtre de service, hybride issu des deux clans ennemis, relégué au second plan, tous comme tous les seconds rôles, rapidement effacés de la scène, se contente de jouer les faire-valoir. Au final, aucun personnage charismatique et une intrigue simpliste plombent ce sous blockbuster pour public peu exigeant. — Moland Fengkov L'idée aurait pu séduire : une guerre entre vampires et loups-garous traversant les siècles, avec en première ligne une belle tueuse partageant la même garde-robe sexy que celle de la Trinity de Matrix. Sur le plan du sex-appeal, Kate Beckinsale n'a rien à envier à Carrie-Ann Moss. Seulement voilà, Underworld échouait à créer un univers propre et original, et ne parvenait pas à sauver son entreprise en passant à côté de ce qui aurait pu constituer son point fort : les scènes d'action. Trop peu nombreuses, trop confuses et trop peu spectaculaires, quand ce genre de film exige une surenchère visuelle face à ses prédécesseurs. Avec le second opus, Underworld 2, les principaux défauts ont été gommés. Plus d'action donc, avec quelques ralentis bien venus et des métamorphoses de lycanthropes plus réussies. Exit les décors urbains, place à la forêt transylvanienne. Hélas, le grand méchant vampire aux traits de gargouille dotée d'ailes de chauve-souris ne procure aucun frisson, et le bellâtre de service, hybride issu des deux clans ennemis, relégué au second plan, tous comme tous les seconds rôles, rapidement effacés de la scène, se contente de jouer les faire-valoir. Au final, aucun personnage charismatique et une intrigue simpliste plombent ce sous blockbuster pour public peu exigeant. — Moland Fengkov
Hostel
Eli Roth
  Quand tout semble avoir été commis en matière d'horreur en général, et de gore en particulier, comment repousser encore les limites spectatorielles ? Par la surenchère. C'est la proposition limitée que fait Hostel de Eli Roth, l'auteur de Cabin Fever, un petit film déjà surestimé dans lequel nous ne voyons qu'un hommage raté à destination d'amateurs du genre. Soutenu par Quentin Tarantino (crédité par un extrait de Pulp Fiction, doublé en slovaque, au détour d'un plan furtif), l'œuvre, si elle est beaucoup plus aboutie n'en demeure pas moins jusqu'au-boutiste. Quand tout semble avoir été commis en matière d'horreur en général, et de gore en particulier, comment repousser encore les limites spectatorielles ? Par la surenchère. C'est la proposition limitée que fait Hostel de Eli Roth, l'auteur de Cabin Fever, un petit film déjà surestimé dans lequel nous ne voyons qu'un hommage raté à destination d'amateurs du genre. Soutenu par Quentin Tarantino (crédité par un extrait de Pulp Fiction, doublé en slovaque, au détour d'un plan furtif), l'œuvre, si elle est beaucoup plus aboutie n'en demeure pas moins jusqu'au-boutiste.
Le réalisateur se contente d'aligner les scènes de tortures les plus cruelles, à défaut d'inventer un récit. A la liste non exhaustive des sévices recensés dans Hostel, qui a produit néanmoins son petit effet au dernier festival de Gérardmer, une énucléation, l'amputation de quelques phalanges, un suicide sur une voie ferrée avec gerbes de sang à profusion... Pas de quoi rendre son quatre heures, mais tout de même un contrat à moitié rempli. Le film s'étire inutilement autour du périple de touristes américains venus goûter au plaisir de la chair en Europe de l'Est, en vue de réserver les scènes choc pour la fin.
Entre-temps, le public masculin aura pu se rincer l'œil devant la plastique pleine de promesses des sirènes censées attirer les vacanciers dans les friches industrielles où les attendent des nantis, réalisant leurs rêves de chirurgiens. — Moland Fengkov
Petites Confidences (A Ma Psy)
Ben Younger
  Rafi Gardet travaille comme photographe dans l'univers new-yorkais de la mode. A 37 ans, sa vie serait une crâne réussite si elle ne venait pas tout juste de divorcer après plusieurs années de vie commune. Quelques jours de mélancolie passent puis, elle accepte l'invitation d'un certain David Bloomberg, croisé lors d'un festival consacré à Michelangelo Antonioni. Elle tombe néanmoins de haut lorsqu'elle apprend son âge, 23 ans. Elle n'est pourtant pas au terme de ses déconvenues puisque son amant n'est autre que le fils aîné de sa psy juive Lisa Metzger. Entre complexes, oedipe, prosélytisme et horloge interne la voici entraînée dans une tourmente bien incongrue. Rafi Gardet travaille comme photographe dans l'univers new-yorkais de la mode. A 37 ans, sa vie serait une crâne réussite si elle ne venait pas tout juste de divorcer après plusieurs années de vie commune. Quelques jours de mélancolie passent puis, elle accepte l'invitation d'un certain David Bloomberg, croisé lors d'un festival consacré à Michelangelo Antonioni. Elle tombe néanmoins de haut lorsqu'elle apprend son âge, 23 ans. Elle n'est pourtant pas au terme de ses déconvenues puisque son amant n'est autre que le fils aîné de sa psy juive Lisa Metzger. Entre complexes, oedipe, prosélytisme et horloge interne la voici entraînée dans une tourmente bien incongrue.
Avec un pitch pareil, on conçoit aisément que le long-métrage aligne les poncifs new-yorkais le plus éculés : naïveté espiègle, ballades nocturnes et romantiques au sein de Manhattan, quiproquos énormes ou désordres familiaux chers à . Etrangement pourtant, un ton savoureux pointe et s'insinue durablement sur fond de jazz et de swing, Coltrane en prime. Sûrement le fait d'une mise en scène limpide qui privilégie au maximum les décors réels, l'infime déconstruction des souvenirs relatés (idéalisés ?), la simplicité ouatée et les riens infimes transperçant subrepticement l'existence. En une seconde et un mouvement de tête dans une salle de cinéma, Uma Thuram exhale une féminité irrépressible que peu de réalisateurs avaient su capter. Le cinéaste-scénariste Ben Younger (Les Initiés) fait montre d'une appréciable maturité dans son déni opiniâtre du cynisme et son abrogation de certaines conventions, une manière goguenarde de plaquer les situations et les stéréotypes, au risque de s'enferrer dans une joliesse un brin artificielle. — Frédéric Flament
Bandidas
Ben Younger
  D'emblée nous sommes saisis par la carence d'ambitions qui jalonne ce long métrage qui, loin de rendre amènes les tribulations des deux superbes actrices callipyges latinos Pénélope Cruz et Salma Hayek ou de renforcer leurs relations dans l'optique d'un buddy movie sympathique, nous enfonce dans les tréfonds de la léthargie. Les velléités de mise en scène sont ainsi minimalistes sans compter l'interprétation ampoulée, ce qui confère à l'ensemble une apathie trépanée. Pour preuve la présence anémiée (sinon anecdotique) d'un Sam Shepard sûrement échappé quelques heures du tournage de Don't Come Knocking. D'emblée nous sommes saisis par la carence d'ambitions qui jalonne ce long métrage qui, loin de rendre amènes les tribulations des deux superbes actrices callipyges latinos Pénélope Cruz et Salma Hayek ou de renforcer leurs relations dans l'optique d'un buddy movie sympathique, nous enfonce dans les tréfonds de la léthargie. Les velléités de mise en scène sont ainsi minimalistes sans compter l'interprétation ampoulée, ce qui confère à l'ensemble une apathie trépanée. Pour preuve la présence anémiée (sinon anecdotique) d'un Sam Shepard sûrement échappé quelques heures du tournage de Don't Come Knocking.
Balourd, le film s'enfonce dans l'auto-parodie jusqu'à se liquéfier lors de la scène hideuse et prétendument véloce de fusillade dans le wagon. Proprement illisible, cette séquence hoquetée avec mouvements de caméra à la Matrix parachève l'errance dégénérative du film. Incapable d'insuffler la moindre topographie des lieux visités, une empathie quelconque avec ses personnages - la mise en scène indigente se cantonne rapidement en un traité méticuleux et esthète de filmage du décolleté des deux femmes - ou simplement une complicité avec un Steve Zahn très loin de sa débonnaire interprétation de Happy Texas, Bandidas périclite tranquillement vers une volatile vacuité : un mirage vaporeux sur la pampa ?
L'entreprise échoue même dans son objectif inconscient s'imposant rapidement comme la fusion d'avec l'idéal télévisuel du Far West. Difficile en effet devant ce spectacle cheap et défectif (l'artificialité du décor de la conversation nocturne est proprement scandaleuse) de ne pas saisir les copeaux d'un imaginaire irrigué par les cathodiques Bonanza, Zorro et autres Mystères De L'Ouest. Les visions du scénariste-producteur Luc Besson sont parfois antagonistes aux aspirations fordiennes, pourtant le pire n'est pas la mastication discourtoise des thèmes forgeant la mythologie américaine mais bien le profond et sordide dédain qui l'anime. Ces fondements se retrouvent ici en toile de fond et nous devenons spectateurs de leurs débattements aussi bien que de leur lénifiant désarroi. D'autant plus dommageable que le vecteur télévisuel a entamé depuis trois ans une profonde introspection avec le radical Deadwood, ou comment se colleter aux récifs sauvages du symbole pour exploser la gangue sirupeuse des mentalités et se frayer un chemin vers l'extase dramaturgique. Retors et couards, les cinéastes norvégiens s'en remettent, eux, au bréviaire-scapulaire prude et famélique du corset. — Frédéric Flament
Les Frères Grimm
Terry Gilliam
  Wilhelm et Jacob Grimm parcourent l'Europe en se faisant passer pour d'authentiques exterminateurs de sorcières, ogres et autres monstres légendaires. Démasqués par Delatombe, un général français, ils doivent partir secourir les enfants d'un village sous la domination d'une force maléfique venue de la forêt voisine. Wilhelm et Jacob Grimm parcourent l'Europe en se faisant passer pour d'authentiques exterminateurs de sorcières, ogres et autres monstres légendaires. Démasqués par Delatombe, un général français, ils doivent partir secourir les enfants d'un village sous la domination d'une force maléfique venue de la forêt voisine.
Première réalisation de Terry Gilliam depuis Las Vegas Parano (1998), Les Frères Grimm est resté dans les cartons de Miramax pendant près d'un an suite à d'incessants problèmes de production. Bien qu'étant un film de commande, la patte de Gilliam est immanquablement présente, que ce soit dans l'histoire ou dans la mise en scène. Ainsi, l'époque dans laquelle se déroule l'histoire et le personnage de Jacob à l'imagination fertile sont à rapprocher des Aventures du Baron de Munchausen ou de Bandits Bandits. De plus, si chaque plan fourmille d'idées visuelles (on notera une séance de torture à base d'escargots et les prisonniers se faisant fouetter en second plan), la mise en scène n'est pas en reste comme l'attestent les excellentes poursuites en forêt. Mais, malgré toute la bonne volonté mise en oeuvre et un couple d'acteurs à la hauteur (Matt Damon et Heath Ledger), les Frères Grimm reste un film bancal. En effet, le récit souffre d'un manque de rythme évident en milieu de métrage et l'histoire fait du sur-place pendant de longues minutes. L'intrigue s'en trouve alors plutôt mince et les personnages secondaires d'un intérêt tout relatif : Cavaldi, interprété par Peter Stormare, en est symptomatique.
Cependant, en raison d'un casting alléchant (Jonathan Pryce, Lena Headey et Monica Bellucci sont aussi de la fête) et d'une réalisation de bonne facture, Les Frères Grimm reste un agréable divertissement entièrement dédié aux contes de notre enfance. Difficile, dans ce cas, de passer à côté du retour de Terry Gilliam. — Nicolas Lorenzon
Shaun of the Dead
Edgar Wright
  Shaun mène une existence morne et sans intérêt, travaille dans un petit magasin et va boire des bières avec sa copine au pub du quartier. Mais, alors qu'une épidémie transforme les londoniens en zombies, il décide de reprendre sa vie en main. Shaun mène une existence morne et sans intérêt, travaille dans un petit magasin et va boire des bières avec sa copine au pub du quartier. Mais, alors qu'une épidémie transforme les londoniens en zombies, il décide de reprendre sa vie en main.
Depuis quelques années, la mode est au film de morts-vivants. Le genre ressuscité par la franchise Resident Evil a, jusqu'à présent, eu beaucoup de mal à convaincre. C'était sans compter sur ce Shaun of the Dead qui se permet de rafler la mise, en rendant un hommage vibrant à tout un pan du cinéma de genre. Car, en lieu et place d'un film gore classique, Edgar Wright choisit de nous livrer une comédie horrifique ultra référentielle, excédant la parodie. Mélangeant sans complexe la comédie romantique loufoque et le film de zombies, Shaun of the Dead fait mouche. Ainsi, les scènes comiques s'enchaînent naturellement avec des scènes d'horreur pure (dont quelques moments assez gore) tout en ne perdant pas de vue l'inévitable critique sociale imposée par le genre depuis les premiers films de George A. Romero. De plus, si le film est ouvertement grand public, il sait aussi flatter le fan du genre puisque les références pleuvent sur toute la durée du métrage (de Peckinpah à Cimino en passant par Carpenter).
Ainsi, porté par un excellent duo d'acteur (Simon Pegg et Nick Frost) et une mise en scène de bonne facture, Shaun of the Dead s'impose incontestablement. — Nicolas Lorenzon
Crazy Kung-Fu
Stephen Chow
  Bien décidé à devenir quelqu'un de respecté dans le milieu de la pègre chinoise des années 40, Sing (Stephen Chow) se fait passer pour un membre du Gang de la Hache pour extorquer un peu de monnaie au coiffeur d'un village. Malheureusement pour lui, les villageois sont plutôt doués pour la castagne... Sing va donc rapidement se retrouver piégé entre le fameux gang et les paysans, ne sachant plus où donner de la tête. Bien décidé à devenir quelqu'un de respecté dans le milieu de la pègre chinoise des années 40, Sing (Stephen Chow) se fait passer pour un membre du Gang de la Hache pour extorquer un peu de monnaie au coiffeur d'un village. Malheureusement pour lui, les villageois sont plutôt doués pour la castagne... Sing va donc rapidement se retrouver piégé entre le fameux gang et les paysans, ne sachant plus où donner de la tête.
Après le succès international de Shaolin Soccer, tout le monde avait les yeux rivés sur Crazy Kung-Fu, le dernier film de Stephen Chow. Se voulant un mélange entre comédie et kung-fu, ce métrage peine malheureusement à tenir toutes ses promesses. Si les intentions sont bien présentes, on peut néanmoins reprocher à l'ensemble un côté franchement bancal. Entre les gags pas toujours drôles et l'accumulation de scènes d'action enrichies aux effets spéciaux numériques, le résultat est franchement mitigé. Étrangement, c'est dans la quasi expérimentation que Stephen Chow marque des points. En nous confrontant à des séquences normalement hors sujet pour un tel film (l'hommage aux cartoons, le drame vécu par la jeune fille), en réalisant un final survolté typiquement oriental et en envoyant des piques aux récents blockbusters, le réalisateur affirme sa volonté de se démarquer de la production d'action classique. En ce sens, Crazy Kung-Fu est loin d'être un échec.
Rehaussé par des acteurs entièrement dévoués à la cause (comme Yuen Qiu et Lam Tze Chung), cette production asiatique tient les promesses du spectacle.
— Nicolas Lorenzon
Elektra
Rob Bowman
  L'honni et pathétique Daredevil, échec artistique total, avait selon les études de consommation une seule qualité, la plastique gracile et les attributs plantureux de Jennifer Gardner. Il est vrai que depuis quatre ans l'héroïne impétueuse d'Alias redéfinit le concept du corps féminin comme un bloc monolithique qui se joue de la sensualité, en se caparaçonnant des fantasmes masculins comme un caméléon change la teinte de sa peau. Elle incarne dans la frénésie d'une histoire alambiquée et d'une réalisation nerveuse le concept même de morbidité de la jouissance, porté aux nues par la troublante Molly Parker dans Suspicious River. Toujours une histoire d'épiderme dans la représentation de la dualité féminité - tantôt forte, tantôt vacante (Julianne Moore dans [Safe]) -, la seule assertion cohérente du lamentable Catwoman que l'interrogation sur la profondeur de l'âme via son enveloppe. Autant dire que voir l'actrice corsetée à nouveau dans le costume de l'intrigante tueuse à gages Elektra avait de quoi séduire dans le sillage d'une esthétique ravivée par Quentin Tarantino. D'autant que l'efficace Rob Bowman, rompu aux exigences de l'immédiateté et de l'épaisseur narrative par son travail sur de nombreux shows télévisés nous refait le coup de la scène d'introduction captivante du Règne Du Feu en instillant une véritable ambiance ainsi qu'une morphologie lourde et reptilienne pour son personnage principal. Il s'agit d'un mythe insaisissable, fulgurant et impitoyable, sadique à ses heures. L'honni et pathétique Daredevil, échec artistique total, avait selon les études de consommation une seule qualité, la plastique gracile et les attributs plantureux de Jennifer Gardner. Il est vrai que depuis quatre ans l'héroïne impétueuse d'Alias redéfinit le concept du corps féminin comme un bloc monolithique qui se joue de la sensualité, en se caparaçonnant des fantasmes masculins comme un caméléon change la teinte de sa peau. Elle incarne dans la frénésie d'une histoire alambiquée et d'une réalisation nerveuse le concept même de morbidité de la jouissance, porté aux nues par la troublante Molly Parker dans Suspicious River. Toujours une histoire d'épiderme dans la représentation de la dualité féminité - tantôt forte, tantôt vacante (Julianne Moore dans [Safe]) -, la seule assertion cohérente du lamentable Catwoman que l'interrogation sur la profondeur de l'âme via son enveloppe. Autant dire que voir l'actrice corsetée à nouveau dans le costume de l'intrigante tueuse à gages Elektra avait de quoi séduire dans le sillage d'une esthétique ravivée par Quentin Tarantino. D'autant que l'efficace Rob Bowman, rompu aux exigences de l'immédiateté et de l'épaisseur narrative par son travail sur de nombreux shows télévisés nous refait le coup de la scène d'introduction captivante du Règne Du Feu en instillant une véritable ambiance ainsi qu'une morphologie lourde et reptilienne pour son personnage principal. Il s'agit d'un mythe insaisissable, fulgurant et impitoyable, sadique à ses heures.
Malheureusement il s'agira de la seule séquence consistante d'un spin-off souffreteux et inepte dont la suite se perd dans une indigence rare et un soporifique ennui au gré d'une lutte manichéenne où forces du bien et du mal s'haranguent et s'affrontent mollement à la recherche du joyau féminin qui apparaît à chaque génération. Et notre lénifiante Jennifer asexuée - plus blasée que son spectateur d'ailleurs - de se retrouver au sein de cette parabole de pacotille - régressive et phallocrate - pour préserver la vie d'Abby et de son père, bien fat, Mark contre une obscure organisation succube. Le reste est à l'avenant entre intrigue frisant la débilité et décors qui ne détonneraient pas dans un épisode de Poltergeist. Cheap à tous les étages jusqu'à l'état de déréliction dans lequel se débat Terrence Stamp, le film ne vaut que pour l'opiniâtreté de son metteur en scène faisant face dans le naufrage notamment par l'utilisation sporadique d'effets spéciaux sympathiques et qui parvient au final à s'octroyer une scène. L'opposition d'Elektra à sa Némésis est ainsi l'occasion de voir la combattante s'ébrouer au milieu de draps blancs spectraux et vaporeux. L'illisibilité et l'ironie de l'action sans atteindre la célérité sauvage des Chroniques De Riddick ou la causticité débonnaire de Constantine, permettent au cinéaste de cautériser la plaie béante de son œuvre artificielle pour achopper les errances de protagonistes falots avec la matière surannée qui préside à la destinée des super-héros Marvel. Toute la différence avec la virtuosité de Sam Raimi qui maintient cette greffe sur plus de deux heures avec le fabuleux Spider-Man 2.
— Frédéric Flament
Capitaine Sky Et Le Monde De Demain
Kerry Conran
  Kerry Conran entreprend avec Capitaine Sky Et Le Monde De Demain une double expérience au cachet étonnant. D'abord celle d'augmenter significativement son court métrage à l'origine de cette singulière aventure, puis celle de filmer la plupart de ses scènes sur fond bleu afin d'incruster et de moduler l'image à loisir et enfin de s'engouffrer avec une fraîche naïveté dans un hommage aux serials d'antan - panégyrique où sont convoqués de multiples références attachantes de Metropolis au Magicien D'Oz en passant par Indiana Jones. Le fait est de reconnaître deux réussites indéniables au long métrage : la dynamique échevelée du couple Gwyneth Paltrow/Jude Law et la totale disparition de la performance technique derrière un charmant ébahissement. Kerry Conran entreprend avec Capitaine Sky Et Le Monde De Demain une double expérience au cachet étonnant. D'abord celle d'augmenter significativement son court métrage à l'origine de cette singulière aventure, puis celle de filmer la plupart de ses scènes sur fond bleu afin d'incruster et de moduler l'image à loisir et enfin de s'engouffrer avec une fraîche naïveté dans un hommage aux serials d'antan - panégyrique où sont convoqués de multiples références attachantes de Metropolis au Magicien D'Oz en passant par Indiana Jones. Le fait est de reconnaître deux réussites indéniables au long métrage : la dynamique échevelée du couple Gwyneth Paltrow/Jude Law et la totale disparition de la performance technique derrière un charmant ébahissement.
L'intrigue simpliste nous transporte à New York en 1939 sur les semelles de la journaliste opiniâtre et maladroite Polly Perkins enquêtant sur les disparitions successives de plusieurs scientifiques renommés. La ville est alors attaquée par une cohorte de robots gigantesques venus dérober les différentes sources énergétiques locales. Heureusement le Capitaine Sky, vaillant aviateur mercenaire, chevaleresque et accessoirement ancien amant de la chroniqueuse, veille et parvient à mettre en déroute la première vague d'assaut. Les deux héros ne tardent pas à découvrir que ces actes barbares ont été fomentés en secret par le savant allemand Totenkopf en vue d'exterminer la race humaine. Une trame narrative jamais dopée par des rôles secondaires copieusement sous-exploités.
Sur un canevas suranné et appliqué, la curieuse audace des protagonistes pointe timidement, celle de la subsistance de l'organique dans le maniérisme virtuel, tout le contraire de l'hideux Vidocq. Peut-être le résultat des jeux de lumière et de contraste qui confèrent une profondeur subtile aux caractères. Ainsi le plus saisissant est d'appréhender non la nostalgie amusée du spectateur mais la mélancolie désabusée de Polly ou de Sky incapables d'expérimenter la transformation - costumes ou brushing glamour inamovibles : si l'histoire rétro éconduit toutes répercussions modernes les personnages n'existent que par leurs illustres aînés, Baccal, Flynn et consorts. La naphtaline sclérosante, l'immatérialité ouatée de la réalisation ou une altérité stérile à peine parasitée par la présence fugitive d'Angelina Jolie (effet d'annonce bien déceptif tant sa présence à l'écran est brève), tels sont frontières infranchissables de l'archétype. Pourtant l'hiératisme demeure absent du film, comme pour souligner les derniers soubresauts de l'utopie - palpable lors de l'escale dans le temple tibétain - : la volonté touchante et un brin profane d'exister malgré ses faiblesses, d'échapper à l'instance paternelle par trop castratrice pour enfin accéder à la maturité identitaire.
— Frédéric Flament
Before Sunset
Richard Linklater
  Le temps réel pour parler du temps qui passe. Before Sunset, suite, neuf ans après (dans la réalité comme dans la fiction) de Before Sunrise, est un grand film derrière des atours de petit film. Ecrit à six mains (Julie Delpy et Ethan Hawke co-signent le scénario avec le réalisateur), cette balade dans la nostalgie et le champ des possibles transpire la vie au sens large et noble du terme. Sans fioriture, le couple d'acteurs, présents à l'écran du début à la fin, se livre, à travers leurs personnages respectifs. L'intime s'immisce subrepticement sous les sujets plus convenus comme la politique ou le travail. Sous les hésitations inhérentes aux conversations où la séduction opère, derrière les mots que l'on cherche pour terminer sa phrase, les personnages parlent de leurs blessures et de leurs espoirs, et, par le truchement de leur sincérité, renvoient le spectateur aux siens. On accompagne littéralement le duo sur le chemin de ses retrouvailles, le long des rues du Quartier latin de Paris. Et lorsque Céline/Julie Delpy finit par empoigner sa guitare et interpréter l'une de ses compositions devant un Jesse/Ethan Hawke conquis d'avance, on regarde soudain sa montre et on se rend compte qu'en bonne compagnie, le temps file avec délice. — Moland Fengkov Le temps réel pour parler du temps qui passe. Before Sunset, suite, neuf ans après (dans la réalité comme dans la fiction) de Before Sunrise, est un grand film derrière des atours de petit film. Ecrit à six mains (Julie Delpy et Ethan Hawke co-signent le scénario avec le réalisateur), cette balade dans la nostalgie et le champ des possibles transpire la vie au sens large et noble du terme. Sans fioriture, le couple d'acteurs, présents à l'écran du début à la fin, se livre, à travers leurs personnages respectifs. L'intime s'immisce subrepticement sous les sujets plus convenus comme la politique ou le travail. Sous les hésitations inhérentes aux conversations où la séduction opère, derrière les mots que l'on cherche pour terminer sa phrase, les personnages parlent de leurs blessures et de leurs espoirs, et, par le truchement de leur sincérité, renvoient le spectateur aux siens. On accompagne littéralement le duo sur le chemin de ses retrouvailles, le long des rues du Quartier latin de Paris. Et lorsque Céline/Julie Delpy finit par empoigner sa guitare et interpréter l'une de ses compositions devant un Jesse/Ethan Hawke conquis d'avance, on regarde soudain sa montre et on se rend compte qu'en bonne compagnie, le temps file avec délice. — Moland Fengkov
Saw
James Wan
  Seven a causé beaucoup de tort au cinéma. Ce bijou de sadisme a, hélas, lancé sur ses traces une pléthore de jeunes réalisateurs rêvant de placer la barre de la perversité toujours plus haut. Sans jamais égaler le talent de David Fincher ou celui de Brian Singer et son cultissime Keyzer Söze. James Wan compte parmi ces jeunes réalisateurs qui croient que se montrer plus malin que le spectateur mène à la réussite de son film. Sans doute que le public adolescent ou amateur de jeux vidéo peut y trouver son compte de sensations, mais au fond, hormis une débauche de sons toujours plus amplifiés pour bien taper sur les nerfs, et une esthétique m'as-tu vu empruntée à l'univers de jeux comme Silent Hill (qui emprunte lui-même le sien à celui d'œuvres du grand écran), on tourne encore plus en rond que les séquestrés du film. L'idée du huis clos dont il s'agit de comprendre pour quelles raisons les protagonistes s'y retrouvent ne souffre pas la durée, surtout lorsque le scénario, qui ne s'épargne aucune incohérence, traîne péniblement le spectateur vers son coup de théâtre final censé arracher un ultime "bah mince alors, j'y aurais jamais pensé !" Finalement, Saw s'en sort uniquement lorsque, sans doute malgré lui, il s'autoparodie par l'humour, notamment dans cette séquence ou l'un des otages simule une mort par empoisonnement, à grand renfort de cabotinage qui ne dupe personne, sinon les sots. Pour le reste, pas de quoi faire un saut sur son siège. — Moland Fengkov Seven a causé beaucoup de tort au cinéma. Ce bijou de sadisme a, hélas, lancé sur ses traces une pléthore de jeunes réalisateurs rêvant de placer la barre de la perversité toujours plus haut. Sans jamais égaler le talent de David Fincher ou celui de Brian Singer et son cultissime Keyzer Söze. James Wan compte parmi ces jeunes réalisateurs qui croient que se montrer plus malin que le spectateur mène à la réussite de son film. Sans doute que le public adolescent ou amateur de jeux vidéo peut y trouver son compte de sensations, mais au fond, hormis une débauche de sons toujours plus amplifiés pour bien taper sur les nerfs, et une esthétique m'as-tu vu empruntée à l'univers de jeux comme Silent Hill (qui emprunte lui-même le sien à celui d'œuvres du grand écran), on tourne encore plus en rond que les séquestrés du film. L'idée du huis clos dont il s'agit de comprendre pour quelles raisons les protagonistes s'y retrouvent ne souffre pas la durée, surtout lorsque le scénario, qui ne s'épargne aucune incohérence, traîne péniblement le spectateur vers son coup de théâtre final censé arracher un ultime "bah mince alors, j'y aurais jamais pensé !" Finalement, Saw s'en sort uniquement lorsque, sans doute malgré lui, il s'autoparodie par l'humour, notamment dans cette séquence ou l'un des otages simule une mort par empoisonnement, à grand renfort de cabotinage qui ne dupe personne, sinon les sots. Pour le reste, pas de quoi faire un saut sur son siège. — Moland Fengkov
Trouble jeu
John Polson
  Depuis quelques années, Hollywood a remis au goût du jour les films dont il ne faut surtout pas raconter la fin à ses amis. Trouble jeu s'inscrit dans cette lignée, en utilisant toutes les (grosses) ficelles du genre : du cauchemar qui vous réveille toutes les nuits à la même heure à l'indispensable couteau de cuisine, en passant par la menaçante cave dont on sort en se prenant un coup de pelle sur le crâne. John Polson se montre bon cuisinier, exploitant les ingrédients et les dosant avec savoir-faire pour concocter un gâteau digeste, mais la cerise à son sommet reste en travers de la gorge. Déception donc, puisque toutes les fausses pistes sur lesquelles il tente de lancer le spectateur finissent en impasses et ne parviennent pas à préserver le terrible secret du film : qui est donc Charlie, ce compagnon de jeu de la petite Emily, que personne n'a jamais vu, mais qui manifeste sa présence par des messages de plus en plus menaçants ? Dans ce film où les personnages secondaires disparaissent trop vite pour créer une quelconque illusion, si bien qu'on ne cherche même plus à savoir le fin mot de l'histoire, l'intrigue se resserre sur trois personnages. Robert De Niro, Famke Janssen et Elisabeth Shue traversent ce thriller en fantômes, au bénéfice de Dakota Fanning, nouveau prodige parmi les enfants stars du cinéma américain, qui parvient, flanquée de son camarade inquiétant, à provoquer quelques sursauts dans la salle. C'est déjà une bonne raison pour qu'on veuille bien la suive de près. — Moland Fengkov Depuis quelques années, Hollywood a remis au goût du jour les films dont il ne faut surtout pas raconter la fin à ses amis. Trouble jeu s'inscrit dans cette lignée, en utilisant toutes les (grosses) ficelles du genre : du cauchemar qui vous réveille toutes les nuits à la même heure à l'indispensable couteau de cuisine, en passant par la menaçante cave dont on sort en se prenant un coup de pelle sur le crâne. John Polson se montre bon cuisinier, exploitant les ingrédients et les dosant avec savoir-faire pour concocter un gâteau digeste, mais la cerise à son sommet reste en travers de la gorge. Déception donc, puisque toutes les fausses pistes sur lesquelles il tente de lancer le spectateur finissent en impasses et ne parviennent pas à préserver le terrible secret du film : qui est donc Charlie, ce compagnon de jeu de la petite Emily, que personne n'a jamais vu, mais qui manifeste sa présence par des messages de plus en plus menaçants ? Dans ce film où les personnages secondaires disparaissent trop vite pour créer une quelconque illusion, si bien qu'on ne cherche même plus à savoir le fin mot de l'histoire, l'intrigue se resserre sur trois personnages. Robert De Niro, Famke Janssen et Elisabeth Shue traversent ce thriller en fantômes, au bénéfice de Dakota Fanning, nouveau prodige parmi les enfants stars du cinéma américain, qui parvient, flanquée de son camarade inquiétant, à provoquer quelques sursauts dans la salle. C'est déjà une bonne raison pour qu'on veuille bien la suive de près. — Moland Fengkov

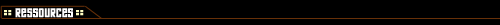
|